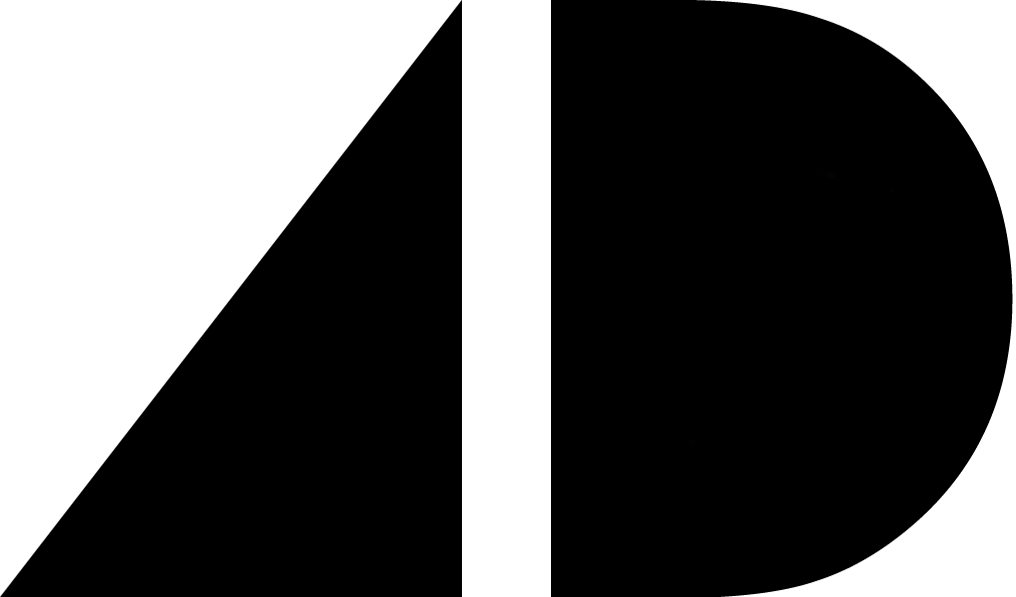Pour notre première fois à Penang en cette saison, je dois avouer que la météo tend plutôt vers le gris. Depuis que nous sommes arrivés, les nuages s’amoncellent au-dessus de nos têtes tous les jours un peu plus nombreux et, bien qu’ils permettent au soleil de briller quelques heures dans la journée, ils laissent échapper leur trop-plein d’humidité plusieurs fois par jour, la nuit en particulier. La chaleur, elle, ne semble pas vouloir décliner. Nous avons toujours aussi chaud et les douches à l’eau à peine froide se succèdent à bon rythme.
Lorsqu’en ouvrant un œil le matin nous remarquons que la tour Komtar se découpe dans un ciel dégagé, nous n’hésitons pas un instant et prenons le bus pour Batu Ferringhi où nous passons la journée allongés sur les transats à remplir consciencieusement des cases de mots croisés ou de sudoku. Je regrette
seulement que la mer, sur cette plage, soit si peu engageante. Avec de l’eau à mi-mollet, on ne se voit même pas les pieds tellement elle est trouble. En plus, les vagues et le courant assez fort n’encouragent pas Chantal à se baigner. Pour ma part, je ne fais que m’y rafraichir. Je suis en train de regarder les scooters qui sillonnent la baie d’un œil distrait, lorsque, à une cinquantaine de mètres du bord, deux dauphins bondissent hors de l’eau en virevoltant avant de retomber au milieu de leurs congénères dont je distingue les ailerons. J’ai à peine le temps d’avertir Chantal qu’ils effectuent un second saut, aussi haut que le premier, devant nos yeux ébahis. Je ne me doutais pas qu’ils venaient si près du bord et nager dans les eaux très fréquentées par les scooters et les canots qui tirent les parachutes ascensionnels. Nous en sommes tous les deux surpris. Ravis du spectacle qu’ils nous ont offert, nous ne les reverrons malheureusement plus de la journée. Pour célébrer cet événement plutôt rare, nous allons déguster un succulent clay pot chicken biryaniau Kapitan, la célèbre spécialité du restaurant indien le mieux coté de la ville. Bien qu’il soit un peu éloigné de l’hôtel, nous avons pris la bonne habitude d’y venir une ou deux fois par semaine ; on ne le regrette jamais.
Nous n’avons pas beaucoup bougé ces derniers temps. Chantal en a profité pour arpenter les centres commerciaux de la ville. Pour ma part, j’ai gardé la chambre et ai gommé un partie du retard pris sur l’écriture du journal, les photos, les copies de disques durs, les mises à jour de logiciels et plein de petites choses qu’on repousse toujours au lendemain. Évidemment, à force de faire les boutiques, Chantal a déniché une jupe longue que je lui réclame depuis des lustres et tient absolument à me la montrer. Même si j’aimerais, je n’ai pas le droit de me débiner. Nous nous rendons donc tous les deux à la boutique Cotton Ondu mall 1st Avenue. Une fois la fameuse jupe réglée, je profite de l’occasion pour essayer un ticheurte en solde. Malgré ma volonté de résister, ma femme souhaite me faire plaisir, elle aussi, et me pousse à
l’acheter ! Je n’en ai pas forcément besoin et pourtant je cède. Ah ! les filles…
Pour une fois, nous allons deux matins de suite au café Awesome : le vendredi et le samedi. Il va falloir faire attention à ne pas trop y prendre goût : les bonnes habitudes s’installent très vite.
Il m’a fallu 24 heures pour télécharger et installer la nouvelle mise à jour de mon MacBook Pro. Et je regrette ! L’ordi avec ses cinq ans et demi semble de plus en plus juste physiquement parlant. Il n’a plus assez de mémoire et sa batterie n’est plus au top. Exactement comme son patron ! Il ne parait pas trop mal conservé malgré quelques égratignures sur le capot, mais il s’épuise très vite lorsqu’on lui donne trop de choses à faire en même temps et ne peut éviter quelques bugs certainement dus à son âge avancé ! Bref, la mise à jour l’a martyrisé et le fait sérieusement ramer. La diminution du nombre de gestes sur le trackpad a rendu difficile la manipulation des photos et me décide à revenir en arrière. Heureusement, j’ai tout sauvegardé il y a deux ou trois semaines et mes travaux quotidiens se trouvant en grande partie sur des disques durs extérieurs je n’aurai pas trop de boulot pour le remettre dans sa configuration première. Vains mots : il me faut la journée entière pour y parvenir. Quarante-huit heures pour faire et défaire, simplement pour revenir au point de départ ; je me suis donné du mal, mais le résultat final (ou initial, je ne sais pas comment le qualifier !) me satisfait. Il faut bien que je m’occupe durant ces périodes nuageuses !
Par une matinée bien ensoleillée, nous prenons le bateau pour Butterworth, la ville juste en face, sur le continent. De gros travaux d’aménagement autour du terminal des ferries rendent la sortie difficile… pour les piétons, une fois de plus. Mais grâce aux applications de nos iPad, nous trouvons assez facilement la route vers le centre-ville ; dangereusement, mais nous y parvenons. Durant cette journée d’errance pédestre, nous ne verrons, en tout et pour tout, qu’un seul zébra. Débrouillez-vous pour traverser au milieu du trafic ! Nous avions oublié que les piétons n’existent pas en Malaisie !
Nous tombons sur la première peinture assez vite. J’ai eu la chance de tourner la tête au bon moment pour l’apercevoir dans une petite rue, devant un immeuble récent, brossée sur une vieille porte en bois reconstituée. Une seconde se trouve de l’autre côté du battant et une troisième tout près de là. L’envie de dénicher de nouvelles murales nous a fait choisir Butterworth et, déjà, je ne regrette pas le voyage. Quant à Chantal qui pensait découvrir une ville attrayante, elle traine sa déconvenue derrière moi, sans trop rien dire. Il est vrai qu’à part ces œuvres peintes les rues n’offrent aucun intérêt. Seul, un temple indien retient un peu notre attention avec sa multitude de statuettes bigarrées. Sinon, les boutiques fermées succèdent de manière lugubre aux locaux
recouverts d’affichettes « à vendre » ou « à louer ». Quelques cantines et commerces de fleurs animent mollement les abords d’un sanctuaire dans lequel des Indiens endimanchés entrent se recueillir. Plus loin, une mosquée nous rend fous avec sa sono trop puissante qui diffuse les appels du muezzin.
Heureusement, sur les murs d’une vieille habitation délabrée dissimulée dans un bosquet, un long chalutier peint nous invite à nous approcher des ruines. Nous y trouvons trois œuvres de l’Anglais Thomas Powell que nous connaissons pour avoir observé d’autres de ses graffitis dans George Town. Superbes et jouant avec les perspectives, elles s’offrent à nous seuls. Quelques secondes avant que je les aperçoive, j’avais en effet demandé à des locaux où elles se trouvaient. Personne n’avait su me répondre, alors qu’elles étaient pratiquement sous leur nez. Incroyable !
Le bus prend la direction de Batu Ferringhi sous un soleil éclatant et nous dépose une demi-heure plus tard juste devant la plage. Allongés sur les transats, nous vaquons chacun à nos occupations : sudoku pour Chantal, mots fléchés pour moi. La veille, à Butterworth, nous avons tous les deux attrapé des coups de soleil. Aussi devons-nous particulièrement nous protéger aujourd’hui. Tartiné de crème, je dois, en plus, me couvrir le crâne d’un vieux bandana qui traine au fond de mon sac. De son côté, Chantal évite d’exposer son dos rougi et abrite son visage derrière une large visière que ne renierait pas une Japonaise. Un vent salvateur venu de la mer parvient tant bien que mal à tempérer la chaleur qui deviendrait vite étouffante sans son aide.
Pour le retour à George Town, nous grimpons au second étage du seul bus double-decker de l’île. De là-haut, la vision sur les quartiers traversés change un peu, mais pas forcément en mieux comme on l’espérait. Nous pouvons ainsi observer ce que nous aurions souhaité ne jamais voir : les innombrables détritus jetés par les fenêtres des immeubles qui jonchent le toit en tôle des cantines et petits commerces en bordure de route. Ces dépotoirs sauvages navrants nous ramènent d’un coup à la réalité. La saleté a encore de beaux moments devant elle ; les rats qui nous passent parfois au ras des orteils nous le rappellent tous les jours.
Une fois encore, nous sommes attristés de constater le nombre de boutiques et commerces fermés depuis notre dernier séjour, il y a simplement trois mois. De Nagore Square où nous promenons, nous pensions l’année passée que le quartier de shophousesrénovées allait devenir l’endroit bobo de George Town avec ses cabinets d’architectes d’intérieur, ses galeries d’art, ses cafés et restaurants branchés, ses boutiques de fringues décalées et ses murales bien connues. Mais, en cette fin d’après-midi, nous ne trouvons que des lieux clos. Un barman qui installe tranquillement quatre tables sur sa petite terrasse nous explique que beaucoup ouvrent à 17 heures. Sait-il seulement que sa montre indique 17 h 30 passées et que les autres établissements ont toujours leurs rideaux métalliques baissés ? Nous avons du mal à croire son affirmation et pensons, par contre, que, comme bien d’autres endroits prometteurs avant lui, celui-ci risque d’être bientôt délaissé par la clientèle jeune et très versatile de Penang.
Le soleil brille de mille feux, mais nous décidons malgré tout d’aller bouquiner dans les fauteuils de l’Eastern & Oriental Hotel. L’accès que nous avons l’habitude d’emprunter est dévié. En cause ? L’affaissement inexplicable d’une partie de la pelouse en front de mer ! Dans sa chute, il a entrainé un vieux canon qui a basculé de son socle et qui git désormais au fond d’un cratère d’une bonne vingtaine de mètres de diamètre et de deux ou trois mètres de profondeur. Dans l’histoire, un palmier royal a pris un air penché et menace de tomber. Nous ne sommes pas experts en la matière, mais nous privilégions la thèse du vice de construction. Les vagues qui paraissent inoffensives ici ont dû saper la base du mur de pierres qui protège l’hôtel de l’océan et aspirer le remblai au fur et à mesure des marées. L’enchevêtrement des racines du gazon a dû retarder quelque temps l’effondrement, mais une mer un peu plus forte a certainement eu raison de cette vaine résistance. Dire qu’il y a deux jours, les invités d’un mariage très chic se pressaient devant le buffet dressé juste à cet endroit ! Ce matin, des hommes en cravate évaluent les dégâts et semblent déjà programmer le calendrier des travaux de réfection.
Lors d’une promenade en ville, je sens Chantal qui s’énerve à côté de moi. Elle râle, à juste titre, après les motos qui empruntent les trottoirs pour contourner les sens interdits. Cette fois, franchement irritée, ce qui ne lui arrive pas si souvent, elle refuse de se ranger et de laisser passer l’impatient Indien ventripotent qui joue bruyamment de l’accélérateur derrière nous. Il devra attendre le prochain bateau aménagé pour effectuer sa manœuvre. Au carrefour suivant, comme si cette journée était à marquer d’une pierre blanche, une voiture manque de lui écraser le pied et une autre la force à s’arrêter alors qu’elle est en train de traverser. Cette fois-ci, elle a eu raison, car la Protonn’aurait pas stoppé… Il y a des jours comme ça !
Comme le samedi matin en général, nous allons prendre un café sur la terrasse bien abritée du soleil, un peu moins de la pluie, de l’Awesome. Je savoure particulièrement l’instant où la serveuse pose les tasses sur le tabouret faisant office de table. Une bonne odeur d’arabica se répand alors et vient flatter nos narines. Mais ce matin, une seconde effluve, pas forcément de celles qu’on apprécie, se mêle à la première. Chantal, plongée dans sa partie de Tetris, ne remarque rien. Pourtant, les relents qui me rappellent ceux humés un jour dans la cave du bar que nous possédions à Rennes m’indisposent vraiment. Une fois son jeu terminé et un nouveau record établi, Chantal confirme mes impressions. Nous commençons à chercher sous nos sièges, autour de nous. Rien ! Alors, je bois pour oublier… mais juste une gorgée, du bout des lèvres. Le café n’y fait rien, la puanteur devient de plus en plus tenace. Chantal va voir dans la cour de l’autre maison, derrière le grillage qui la sépare de l’Awesome, et pousse un cri de dégoût. À moins de deux mètres de nos sièges, un rat crevé, gros comme un lapin, attend de sécher au soleil ! Peu emballés à l’idée de le faire disparaître nous-mêmes, nous demandons au serveur du bistrot de bien vouloir l’enlever ; ce qu’il fait avec une mine si dégoutée qu’on se bidonne, tous les deux, à s’en dilater la… rate !
Les travaux de réfection ont commencé sur la pelouse du palace. Celle de la partie effondrée a été découpée en carrés que des jardiniers peu regardants ont étalés, retournés, en plein cagnard. Même de loin, on peut apercevoir les racines déjà grillées. Par ailleurs, pour arriver jusqu’au cratère, un bulldozer a dévasté une bonne partie de la pelouse restée intacte après l’accident. On ne peut réprimer un petit sourire, mais leur conception du travail bien fait est vraiment trop éloignée de la nôtre…